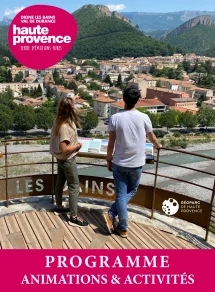Perchée sur le rocher de Sainte-Madeleine surplombant la vallée des Duyes et le village de Thoard, la chapelle du même nom, datant de 1657, a été entièrement restaurée en 2002 par l'artiste Andy Goldsworthy elle fait partie de l’œuvre Refuge d'Art.
Détail de l'itinéraire
Description
N’hésitez pas à pénétrer à l’intérieur de la chapelle, Andy Goldsworthy** intervient ici sur la totalité du bâtiment. Le mur du fond est doublé d’un appareillage régulier de pierres taillées au centre duquel une cavité en forme d’œuf permet de se tenir debout. C’est là que « d’autres se sont tenues avant, et où d’autres se tiendront après », dit l’artiste. Il conçoit ce dispositif pénétrable comme un écrin qui conserve la mémoire des visiteurs, témoin de leur présence, mais également de leur absence en ce lieu.
**Andy Goldsworthy (Sale Moor, Angleterre, 1956) place la nature au cœur de son travail. Mais sans réduire ses œuvres aux matériaux naturels, ni aux processus naturels qui les traversent, il prend en compte la nature du lieu et son histoire. Ceci explique pourquoi Andy Goldsworthy travaille essentiellement dans des lieux marqués par la présence humaine.
Refuge d’Art est une seule œuvre d’art à parcourir en une dizaine de jours de marche. Elle se compose aujourd’hui de sept refuges et de trois Sentinelles reliés par un chemin. À l’origine, de vieux bâtiments agricoles abandonnés, une chapelle en ruine, des cabanes de berger effondrées… fondent le projet de leur restauration par l’artiste, afin d’accueillir une œuvre et d’abriter les marcheurs et randonneurs.
Sur la façade de la chapelle, partez à la recherche d’un point doré, gravé dans la pierre. Il s’agit de point, de l’artiste herman de vries*(2009). Pour l’artiste, la simplicité du point interdit toute interprétation, il capture l’attention du marcheur, pour l’interroger et l’inviter vers d’autres pensées. Quel que soit l’endroit où l’on est et où l’on va, point vous invite à aller plus loin ! herman de vries* est naturaliste de métier. Son regard sur le monde est fortement influencé par la philosophie orientale. Pour lui, la nature se suffit à elle-même et n’a pas besoin d’être embellie par l’art : « la nature est art », dit-il, car elle est création perpétuelle.
* nous respectons la volonté de l’artiste de ne pas utiliser de majuscule, forme de hiérarchie.
Formé il y a environ 220 millions d’années dans une lagune sursalée, le gypse est une roche tendre composée de sulfate de calcium. Chauffée dans un four, il perd son eau par évaporation et se transforme en plâtre. Puis, après avoir été broyé à l’air libre ou dans un moulin, il peut être réhydraté et utilisé dans la construction. Au XIXe siècle, de nombreux petits lieux d’extraction existaient en Haute-Provence. L’architecture traditionnelle offre de multiples utilisations du plâtre : du plus grossier servant de mortier pour la construction des murs au plus fin usité pour la réalisation des gypseries. À Thoard, des carrières de gypse sont attestées dès 1840 mais, sans doute l’extraction a-t-elle commencée bien plus tôt. La mieux connue est la carrière du Siron mentionnée à partir de 1890 qui fut exploitée jusqu’en 1940. La pierre était extraite à ciel ouvert au pic et à la pioche puis chargée sur des traîneaux utilisés couramment dans la vallée pour les travaux agricoles dans les zones de fortes pentes. Elle était ainsi transportée jusqu’au village à la fabrique de plâtre. Là, un moulin fonctionnant à l’énergie hydraulique, née d’une chute sur le torrent du Riou, actionnait une lourde meule de pierre verticale.
**Andy Goldsworthy (Sale Moor, Angleterre, 1956) place la nature au cœur de son travail. Mais sans réduire ses œuvres aux matériaux naturels, ni aux processus naturels qui les traversent, il prend en compte la nature du lieu et son histoire. Ceci explique pourquoi Andy Goldsworthy travaille essentiellement dans des lieux marqués par la présence humaine.
Refuge d’Art est une seule œuvre d’art à parcourir en une dizaine de jours de marche. Elle se compose aujourd’hui de sept refuges et de trois Sentinelles reliés par un chemin. À l’origine, de vieux bâtiments agricoles abandonnés, une chapelle en ruine, des cabanes de berger effondrées… fondent le projet de leur restauration par l’artiste, afin d’accueillir une œuvre et d’abriter les marcheurs et randonneurs.
Sur la façade de la chapelle, partez à la recherche d’un point doré, gravé dans la pierre. Il s’agit de point, de l’artiste herman de vries*(2009). Pour l’artiste, la simplicité du point interdit toute interprétation, il capture l’attention du marcheur, pour l’interroger et l’inviter vers d’autres pensées. Quel que soit l’endroit où l’on est et où l’on va, point vous invite à aller plus loin ! herman de vries* est naturaliste de métier. Son regard sur le monde est fortement influencé par la philosophie orientale. Pour lui, la nature se suffit à elle-même et n’a pas besoin d’être embellie par l’art : « la nature est art », dit-il, car elle est création perpétuelle.
* nous respectons la volonté de l’artiste de ne pas utiliser de majuscule, forme de hiérarchie.
Formé il y a environ 220 millions d’années dans une lagune sursalée, le gypse est une roche tendre composée de sulfate de calcium. Chauffée dans un four, il perd son eau par évaporation et se transforme en plâtre. Puis, après avoir été broyé à l’air libre ou dans un moulin, il peut être réhydraté et utilisé dans la construction. Au XIXe siècle, de nombreux petits lieux d’extraction existaient en Haute-Provence. L’architecture traditionnelle offre de multiples utilisations du plâtre : du plus grossier servant de mortier pour la construction des murs au plus fin usité pour la réalisation des gypseries. À Thoard, des carrières de gypse sont attestées dès 1840 mais, sans doute l’extraction a-t-elle commencée bien plus tôt. La mieux connue est la carrière du Siron mentionnée à partir de 1890 qui fut exploitée jusqu’en 1940. La pierre était extraite à ciel ouvert au pic et à la pioche puis chargée sur des traîneaux utilisés couramment dans la vallée pour les travaux agricoles dans les zones de fortes pentes. Elle était ainsi transportée jusqu’au village à la fabrique de plâtre. Là, un moulin fonctionnant à l’énergie hydraulique, née d’une chute sur le torrent du Riou, actionnait une lourde meule de pierre verticale.